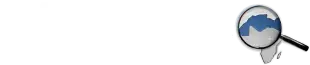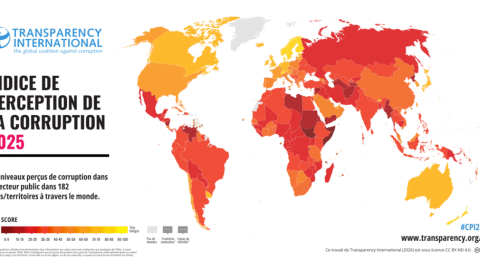La révision de la loi n°103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, entrée en vigueur en septembre 2018, s’annonce comme l’un des chantiers juridiques et sociétaux les plus sensibles du moment. Pourtant, une question majeure s’impose : comment un ministère dirigé par une responsable issue du parti de l’Istiqlal, formation historiquement reconnue pour avoir alimenté l’appareil d’État en cadres juridiques et administratifs aguerris, peut-il confier l’élaboration d’une telle réforme à un cabinet privé ?
Pourtant, la ministre Naïma Ben Yahya avait affirmé que la révision tiendrait compte des études, diagnostics et évaluations réalisés par le Parlement, les secteurs gouvernementaux et le pouvoir judiciaire, ainsi que des propositions de la société civile. Sur le principe, la méthode semble inclusive. Dans les faits, l’externalisation de la rédaction soulève des interrogations profondes.
D’autant plus que, le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille abrite en son sein la Direction de la Femme, structure spécialisée disposant d’expertise juridique, sociale et institutionnelle accumulée depuis des années. C’est cette même administration qui pilote les politiques publiques en matière d’égalité, de protection et d’inclusion.
Pourquoi, dès lors, déléguer à un cabinet privé l’élaboration technique d’un texte qui engage des dimensions pénales (révision des incriminations, circonstances aggravantes, procédures), des dimensions religieuses et sociétales (statut de la famille, normes culturelles), des engagements internationaux du Maroc et des équilibres institutionnels sensibles ?
Un cabinet privé, aussi compétent soit-il, peut-il appréhender avec la même profondeur les subtilités du droit pénal marocain, les référentiels religieux, les contraintes constitutionnelles et les pratiques judiciaires effectives ?
Le rôle central du Parlement et des institutions nationales
Il faut également rappeler que la réforme ne part pas d’une page blanche. Le groupe de travail thématique temporaire chargé de l’évaluation des conditions de mise en application de la loi 103-13 (Législature 2021-2026) a déjà produit des diagnostics détaillés. De même, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), saisi en 2016 par la Chambre des représentants, avait rendu un avis structurant sur le projet initial.
Autrement dit, les bases techniques, juridiques et normatives existent déjà au sein des institutions publiques.
La réforme de la loi 103-13 n’est pas un simple ajustement administratif. Elle redéfinit la manière dont l’État protège les femmes, sanctionne les auteurs et articule droit pénal, droit de la famille et engagements internationaux.
Confier l’architecture d’un tel texte à un cabinet privé pose une question de souveraineté normative. La production de la norme pénale relève du cœur régalien de l’État. Elle engage la responsabilité politique du gouvernement et la légitimité du Parlement.
L’expertise externe peut enrichir un processus. Elle ne peut s’y substituer. La révision gagnerait à être pilotée par les compétences internes du ministère, en articulation étroite avec le Parlement, le pouvoir judiciaire, les institutions constitutionnelles et la société civile.
Restaurer la cohérence institutionnelle
Si la ministre affirme que la réforme s’appuie sur les diagnostics du Parlement, du gouvernement et de la société civile, alors la logique institutionnelle voudrait que ces mêmes acteurs soient au centre du processus d’élaboration, et non relégués au rang de simples contributeurs.
Dans un domaine aussi sensible, la crédibilité du texte dépendra autant de son contenu que de sa méthode d’élaboration. Transparence, participation réelle, ancrage institutionnel et cohérence juridique seront déterminants.
Au-delà du débat partisan, la question est simple : la réforme de la loi 103-13 doit-elle être un produit externalisé, ou l’expression d’une volonté publique assumée, portée par les institutions de l’État et enrichie par la société civile ?
La réponse conditionnera non seulement l’efficacité future du dispositif, mais aussi la confiance dans la capacité des institutions à porter elles-mêmes les réformes qu’elles annoncent.