
L’Algérie assiste, impuissante, à l’érosion de son influence énergétique en Europe. Longtemps présentée comme un fournisseur « stratégique » pour le Vieux Continent, elle voit désormais ses parts de marché fondre au profit des États-Unis, nouveaux maîtres du gaz naturel liquéfié (GNL).
Selon une étude de l’OAPEP publiée le 2 septembre 2025, les parts combinées de l’Algérie et du Qatar sont tombées de 36 % avant 2022 à seulement 22 % aujourd’hui. Dans le même temps, les Américains ont presque doublé leur poids, grimpant de 28 % à 46 %, devenant le premier fournisseur de GNL à l’Europe.
Cette bascule n’est pas seulement économique : elle est éminemment politique. La guerre en Ukraine a accéléré la stratégie européenne d’émancipation énergétique, formalisée par le plan REPowerEU, qui prévoit la fin des importations de gaz russe d’ici 2027. Bruxelles impose en parallèle de nouvelles normes environnementales, comme la réglementation sur le méthane (2024), qui compliquent l’accès au marché pour des producteurs jugés peu compétitifs, comme Alger.
En arrière-plan, c’est toute la politique énergétique algérienne qui se trouve fragilisée. Incapable de diversifier son économie, Alger mise toujours presque exclusivement sur les hydrocarbures pour financer ses importations et acheter la paix sociale. Mais avec une demande gazière européenne en déclin structurel, le pays risque de perdre à la fois ses devises et son rôle d’acteur stratégique.
Pendant que Washington capitalise sur sa diplomatie énergétique et que Doha mise sur des investissements massifs, Alger reste engluée dans une gestion technocratique et centralisée, incapable d’anticiper la transition. Même la Russie, pourtant sous sanctions, conserve 17 % du marché européen en 2024, contre 12 % en 2023, preuve que l’Algérie recule plus vite que ses concurrents.
Face à ce constat, l’OAPEP tente de sauver les apparences en plaidant pour que le gaz soit reconnu comme une « énergie de destination » et non plus une simple étape transitoire. Mais le temps joue contre Alger : sa rente gazière, jadis levier d’influence diplomatique, se transforme peu à peu en vulnérabilité stratégique.
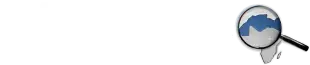






oui, l’Algérie ferai bien de se recycle dans le commerce du haschisch et autres drogues comme son honnête voisin dealer sous silencieux.
Malheureusement même ça elle ne saurait pas faire, c’est vraiment un pays de bras cassés, il n’y a plus rien à foutre dans ce pays de merde, les algériens qui ont un peu de jugeote prennent le bateau pour faire la traversée de la Méditerranée
Les plus grand trafiquant de drogue ce nomme Khaled Teboun (hachakoum) le Pablo Escobar de la Corée de l’est .
Très bonne idée 👍
L’UE et malgré elle dépendante du GAZ Algérien quoi que puisse affabuler les crapaud qui pensent pouvoir tenir l’image de la Colombe Algérie avec leurs baves crasseuses et nauséabondes 🤫
c’est vrai ce monsonge mr le journalier
journaliste je ne crois pas
L’Algérie vous emmerde à pied, à cheval et en voiture !!!
Pour mériter les faveurs de votre journal, il faudrait que l’Algérie se livre au tourisme sexuel, déroule le tapis rouge aux pédophiles du monde entier, se reconvertisse dans la culture massive de la zatla, et scelle une normalisation servile avec Israël.
pour mériter les faveurs de votre journal, il faudrait que l’Algérie se livre au tourisme sexuel, déroule le tapis rouge aux pédophiles du monde entier, se reconvertisse dans la culture massive de la zatla et scelle une normalisation servile avec Israël.
Puisque ce site est d’obédience maroki, il dénigre. Mais qu’en est-il du Journal Le Monde qui a mis ànu le Roi momo6 et la famille royale
Pas mal, on a vos maîtres comme concurrents pour l’instant, on attendant la découverte d’énormes gisements de pétrole et de gaz au royaume pour vous avoir comme concurrent vous aussi ( quand vous serez assez grands).
Les dernières entreprises qui cherchaient chez vous et sur vos cotes n’ont trouvés que dalle, ils ont pliés bagages 😁
Même les chiens arrêtent d’aboyer à un moment, mais vous non🤔
ces marocains ne reculent devant rien. l’Algérie est devenue leur cauchemar.surtout depuis que Aami Tebboune a exaucé la volonté du peuple au non renouvellement du contrat du gazoduc qui leur profite largement aux marocains ,concernant leur consommation et les dividendes sur le passage des gazoduc .pour le gaz de consommation en plus du vol de gaz ,avec un prix symbolique,croyant que ce sont nos voisins -freres . Leurs trahisons et leur vouloir caché a nuire à tout ce qui est Algérien , l’Algérie a procédé a couper toutes relations et le non renouvellement du contrat gazier arrivé à son terme .une très grosse déception pour le Maroc qui achète désormais son gaz des marchés au prix réel
encore un torchon article à l’article par les Marocains sionistes qui feraient mieux de s’occuper de leur maman qui font cocu leur père avec les Africains dans les champs de fraises