
Sans vouloir paraphraser la fameuse citation du général De gaule qui lui aurait été attribuée : « des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Le secrétariat d’état à la pèche a organisé un symposium sur le petit pélagique. Plutôt que d’attendre et de devoir agir dans l’urgence, le secrétariat d’état a préféré agir dans l’anticipation.
Sous le soleil de Rabat, les plus grands spécialistes mondiaux des petits pélagiques se sont réunis pour parler… de poissons, certes, mais surtout de climat. Car derrière les mots “sardine”, “anchois” ou “maquereau”, c’est toute la mécanique de la mer qui semble grippée.
Les vagues de chaleur marines se multiplient, la production planctonique baisse, et les bancs de poissons changent de route. Pour le Maroc, premier producteur pélagique d’Afrique, ces changements ne sont pas des projections : ils sont déjà visibles. Les captures ont chuté de près de 40 % cette année, les poissons sont plus petits, et les saisons plus instables.
Le symposium international sur les petits pélagiques, tenu à Rabat, a permis de mettre des mots, des chiffres et surtout des solutions sur le changement climatique et la surexploitation qui déstabilisent la base même de la productivité marine.
Des scientifiques unanimes : “le climat a pris la main sur la ressource”
Le chercheur chinois Shizhu Wang a montré comment les nouvelles bouées “intelligentes” développées par son institut mesurent en continu la température, les courants et la biomasse marine. Une révolution à bas coût qui permet de suivre en temps réel les signaux de stress écologique.
Appliquée à la façade marocaine, cette technologie pourrait devenir le radar climatique de la pêche nationale.
Du côté de la FAO, le Dr Arnault Le Bris a confirmé que la région Canaries–Sahara est aujourd’hui un des points chauds du réchauffement marin mondial : hausse record de la température, baisse continue de la chlorophylle (–0,28 mg/m³ par décennie), productivité en déclin. Il plaide pour que le Maroc intègre les données climatiques dans ses quotas de pêche : un acte de modernité autant qu’un réflexe de survie.
Portugal, Afrique du Sud, Pérou : trois leçons pour le Maroc
Le Portugal a connu l’effondrement de sa sardine dans les années 2010. Grâce à la rigueur scientifique et au dialogue avec les pêcheurs, la ressource est revenue. “Nous avons fermé des zones pour sauver la ressource, et rouvert pour faire durer l’ecosysteme ”, a résumé la chercheuse Suzana Garrido, qui dirige le projet Sardinha 2030.
L’Afrique du Sud, elle, gère depuis vingt ans ses petits pélagiques grâce à une règle transparente : les quotas suivent la science. Le Dr Janet Coetzee explique : “Chaque année, nos TAC montent ou descendent selon les données acoustiques. Cela évite la panique, protège les stocks et préserve les emplois.” Leur modèle de procédure opérationnelle de gestion (OMP) pourrait inspirer la réforme marocaine des quotas.
Enfin, le Pérou, géant mondial de la pêche, illustre les dérives à éviter : surcapacité, prises massives de juvéniles et dépendance à la farine de poisson. La professeure Patricia Majluf a rappelé que “l’alimentation humaine crée trois fois plus d’emplois que la farine” — un argument de poids pour que le Maroc réoriente sa production vers la consommation locale et la valeur ajoutée.
Un Maroc à la croisée des chemins
Le Maroc occupe une place unique au monde : entre le courant froid des Canaries et celui du Benguela, deux des écosystèmes les plus productifs — mais aussi les plus vulnérables — de la planète.
Cette position géographique en fait le pivot de la durabilité halieutique atlantique.
Les experts réunis à Rabat ont été clairs : “Le Maroc a les moyens techniques, humains et industriels pour devenir le modèle africain de la pêche durable — à condition d’écouter la science.”
Concrètement, plusieurs priorités émergent :
1. Créer un Observatoire national Océan–Climat–Pêche pour suivre en temps réel les signaux environnementaux.
2. Standardiser la collecte de données de pêche (zones, effort, juvéniles).
3. Lancer des campagnes acoustiques biannuelles, comme au Portugal et en Afrique du Sud.
4. Mettre en place un système de gestion adaptatif : des quotas qui évoluent selon la biomasse et la température.
5. Valoriser le petit pélagique en consommation humaine : filets, conserves, plats cuisinés — un potentiel industriel et social
Une nouvelle ère bleue
À Rabat, le ton était grave mais porteur d’espoir. Le pire n’est pas toujours certain , mais il est malheureusement probable .
Les crises vécues ailleurs montrent qu’agir tôt coûte moins cher que réparer tard. Les petits pélagiques ne sont pas qu’un enjeu halieutique : ils sont le baromètre de la santé de l’océan et de l’économie bleue marocaine.
Le Maroc a tout pour réussir : la mer et la science. A ces deux paramètres il faudrait leur adjoindre la volonté et surtout l’adhésion de tout le monde a un manuel de procédures qui doit être le reflet d’un aménagement juste qui respecte les règles de base de l’accès a la ressource et de l’effort de pêche . Pour cela il se doit d’être équitable et transparent. La science est certes indispensable mais ne peut pas être la seule béquille car comme le disait Rabelais : « science sans conscience, n’est que ruine de l’âme ».
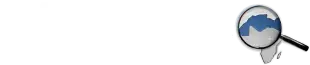






oui c vrai, au maroc il nous faut une pêche équitable et transparente .