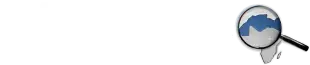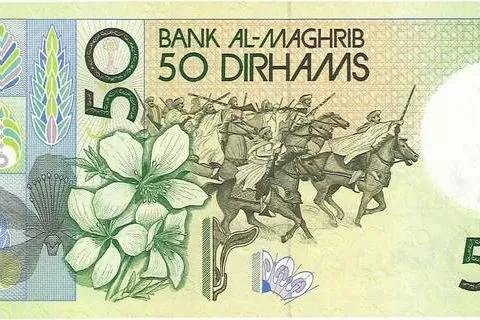La proposition d’autonomie avancée par le Maroc s’impose aujourd’hui comme une approche réaliste et moderne de l’autodétermination interne. Elle n’est pas le produit d’un hasard diplomatique, mais le fruit d’une réflexion stratégique, patiemment conduite sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. Cette vision, à la fois lucide et tournée vers l’avenir, place le Royaume parmi les rares États à avoir su transformer un dossier politique sensible en un modèle institutionnel durable. Cependant comme pour toute mutation , des écueils existent et il n’est pas permis sans prendre de grands risques de sous-estimer n’importe quel danger.
Un cadre qui s’inscrit dans le droit international contemporain
Dans les débats actuels sur la gouvernance des territoires, la distinction entre autodétermination interne et autodétermination externe prend tout son sens.
La première n’est pas synonyme de séparation, mais de participation locale au sein d’un État souverain. C’est dans cette perspective que s’inscrit le projet marocain : une autonomie qui renforce la souveraineté, au lieu de la contester.
Cette orientation juridique n’a rien d’exceptionnel : elle reflète l’évolution du droit international, qui privilégie désormais l’inclusion institutionnelle plutôt que la rupture. Elle traduit aussi la maturité d’un État qui maîtrise ses réformes et anticipe ses transitions.
Garantir la stabilité des règles et la continuité des engagements
Pour les acteurs économiques comme pour les juristes, la clé du succès réside dans la stabilité normative.
Les investissements réalisés dans les provinces du Sud doivent bénéficier d’une protection explicite, inscrite au plus haut niveau de la hiérarchie des normes.
Plusieurs experts suggèrent ainsi l’introduction d’un article constitutionnel garantissant que les droits acquis avant l’entrée en vigueur du statut d’autonomie demeurent pleinement protégés, et ne peuvent être modifiés qu’en conformité avec la loi nationale.
Ce principe, déjà appliqué au Groenland, au Nunavut ou en Nouvelle-Calédonie, préserverait la confiance et éviterait toute insécurité juridique.
Dans la même logique, l’idée d’une juridiction mixte — composée de représentants du Royaume et de la région autonome refait surface. Elle aurait pour rôle de trancher les différends entre opérateurs et autorités régionales et de prévenir toute dérive politique ou économique. Un dispositif de clause de stabilité juridique dans les contrats, assorti d’un fonds de compensation financé localement, permettrait d’absorber les effets d’éventuels ajustements institutionnels.
Les engagements internationaux du Maroc, un socle de crédibilité
Le Maroc dispose déjà d’un atout considérable : ses accords bilatéraux de protection des investissements assurent la non-discrimination, la protection contre l’expropriation et la libre transférabilité des capitaux. Ils prévoient aussi le recours à l’arbitrage international, garantissant ainsi un environnement fiable pour les investisseurs.
Dans ce contexte, personne ne viendra contester la pertinence : l’autonomie ne changera rien à la personnalité juridique du Royaume. Les engagements internationaux resteront pleinement valides, renforçant la confiance des partenaires et la continuité du climat d’affaires.
Vers une gouvernance économique concertée et transparente
Au-delà du droit, c’est la méthode de gouvernance qui retiendra l’attention. Beaucoup d’opérateurs plaident pour la création d’un Conseil économique régional, réunissant élus sahraouis ,représentants de l’État et acteurs privés. Cette instance pourrait examiner toute nouvelle licence, réforme sectorielle ou attribution de projet, sur la base d’une concertation obligatoire et d’une étude d’impact.
Ce type de codécision, inspiré du modèle danois appliqué au Groenland, permettrait d’éviter les ruptures de confiance et de consolider le sentiment de responsabilité partagée. « Il faut conjuguer souveraineté et coresponsabilité ; c’est ainsi que naît la confiance », résume un opérateur du secteur halieutique.
________________________________________
Un corps électoral de droit commun, pour une citoyenneté partagée
La question du corps électoral figure aussi parmi les points cruciaux. Les experts s’accordent sur la nécessité d’un modèle d’intégration totale, où tout citoyen marocain résidant dans les provinces du Sud participe aux élections régionales.
Ce système, proche de ceux en vigueur en Catalogne ou aux îles Canaries, consoliderait la cohésion nationale et l’égalité politique entre les citoyens. La tenue du registre électoral par le ministère de l’Intérieur, sous supervision régionale, garantirait à la fois transparence et sécurité.
Un projet d’équilibre et de confiance
L’autonomie marocaine apparaît aujourd’hui comme un projet d’équilibre : équilibre entre souveraineté et participation, entre droit et économie, entre stabilité et innovation.
Elle ne se réduit pas à une solution politique ; c’est une approche de gouvernance, ancrée dans la durée, qui repose sur deux piliers : la confiance des citoyens et la sécurité des investissements seule garantie du développement et bien être des populations .Devant cet argument massue et cette jungle d’objectifs divergents , il n’est plus nécessaire d’être juriste pour défendre des causes justes