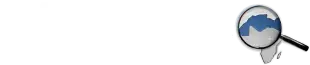La campagne des « speedomètres » devait incarner la fermeté de l’État. Elle a finalement révélé un appareil fragilisé, une stratégie mal calibrée et un climat social explosif. Au centre de la tempête : la NARSA et son directeur général, Benacer Boulaâjoul, accusés d’avoir transformé un outil de régulation en facteur de division.
Une NARSA obsédée par son rôle budgétaire
Selon des observateurs, la NARSA n’a pas seulement voulu contrôler la vitesse des deux-roues. L’agence cherchait aussi à démontrer qu’elle pouvait jouer un rôle central dans l’élargissement des recettes de l’État, en se posant comme acteur financier clé à l’approche des grands rendez-vous sportifs que sont la Coupe d’Afrique et la Coupe du Monde 2030. Mais cette logique de rendement a occulté l’essentiel : le climat social. En ciblant directement les cyclomoteurs, outil de survie des livreurs, ouvriers et étudiants, la NARSA a donné l’image d’une institution qui frappe les plus fragiles plutôt que de réguler le marché en amont.
Une circulaire bancale, un climat explosif
La mesure a été perçue comme punitive, arbitraire et juridiquement fragile. Une simple circulaire n’a pas la valeur de loi, et aucune disposition ne contraint un conducteur à enfourcher sa moto pour un test de vitesse. En cas d’accident lors d’un contrôle, la responsabilité de l’État aurait été directement engagée. À cela s’ajoute l’absurdité d’un seuil fixé à 58 km/h, alors même que l’homologation et l’importation autorisent déjà des véhicules plus rapides. Au lieu de verrouiller le système en amont, la sanction a été déplacée vers le dernier maillon : l’usager final.
Suspension par circulaire et désaveu implicite
Face à la contestation sociale, les instructions de suspendre la campagne ont été données au sommet, et la décision a été formalisée par une circulaire signée par le ministre du Transport. Une mécanique qui souligne moins la responsabilité individuelle d’un ministre que le désaveu collectif d’un dispositif mal pensé. La NARSA, qui voulait se placer comme partenaire incontournable de l’État dans la collecte de recettes, s’est retrouvée marginalisée et exposée comme un acteur de tensions.
Une agence déjà en perte de crédibilité
Cette polémique ne fait que s’ajouter à une série d’échecs récents. En 2024, le baromètre routier a enregistré une hausse de 8,6 % des blessés graves, signe d’une stratégie nationale en panne malgré des moyens financiers considérables. En 2025, l’annulation de l’appel à concurrence pour les centres de contrôle technique a plongé les opérateurs privés dans l’incertitude et renforcé l’image d’une institution incapable de mener ses projets à terme. Même les nouveaux radars bidirectionnels et les campagnes estivales renforcées n’ont pas inversé la tendance : entre janvier et mai 2025, 1 624 morts et plus de 4 000 blessés graves. Ces chiffres contredisent les effets d’annonce et illustrent une agence technocratique engluée dans la bureaucratie, dépensant sans produire de résultats visibles.
Un directeur général désormais sur la sellette
La séquence actuelle pourrait marquer un tournant pour le directeur général de la NARSA. Déjà fragilisé par les critiques récurrentes sur l’inefficacité de son agence et par une série de rapports accablants, il se retrouve désormais exposé au premier plan d’un fiasco politique et social. La gestion précipitée de l’opération des speedomètres, annulée sous pression en l’espace de quelques jours, illustre un manque de sens politique autant que de maîtrise de terrain. À cela s’ajoute une image publique dégradée, celle d’un haut responsable déconnecté des réalités sociales et focalisé sur les recettes et l’affichage budgétaire plutôt que sur la sécurité routière ou la cohésion nationale. Dans ce contexte, beaucoup voient dans cette affaire non seulement une erreur de stratégie, mais aussi le début de la fin pour la direction actuelle de l’agence.
Une crise qui dépasse la route
Au-delà des chiffres, cette affaire illustre une contradiction plus profonde. Le dernier discours royal rappelait que le Maroc ne peut pas être un État qui roule à deux vitesses : l’un pour les privilégiés, l’autre pour les catégories populaires. Or la NARSA, en ciblant les motos des livreurs et des étudiants, a accentué cette fracture sociale. Ce qui devait être un instrument de sécurité routière est devenu un symbole d’injustice. La sécurité, censée rassembler, s’est transformée en ligne de division.
La suspension des speedomètres n’est pas un simple ajustement technique. C’est un signal politique clair : la sécurité routière ne peut pas se construire contre les catégories les plus modestes. La NARSA, qui voulait démontrer son utilité budgétaire, se retrouve accusée d’avoir fragilisé la cohésion sociale. À l’approche de la CAN et de la Coupe du Monde, la question n’est plus seulement celle des radars ou des circulaires, mais bien celle de savoir si l’État saura corriger ses incohérences pour ne pas répéter, à plus grande échelle, un fiasco devenu emblématique.